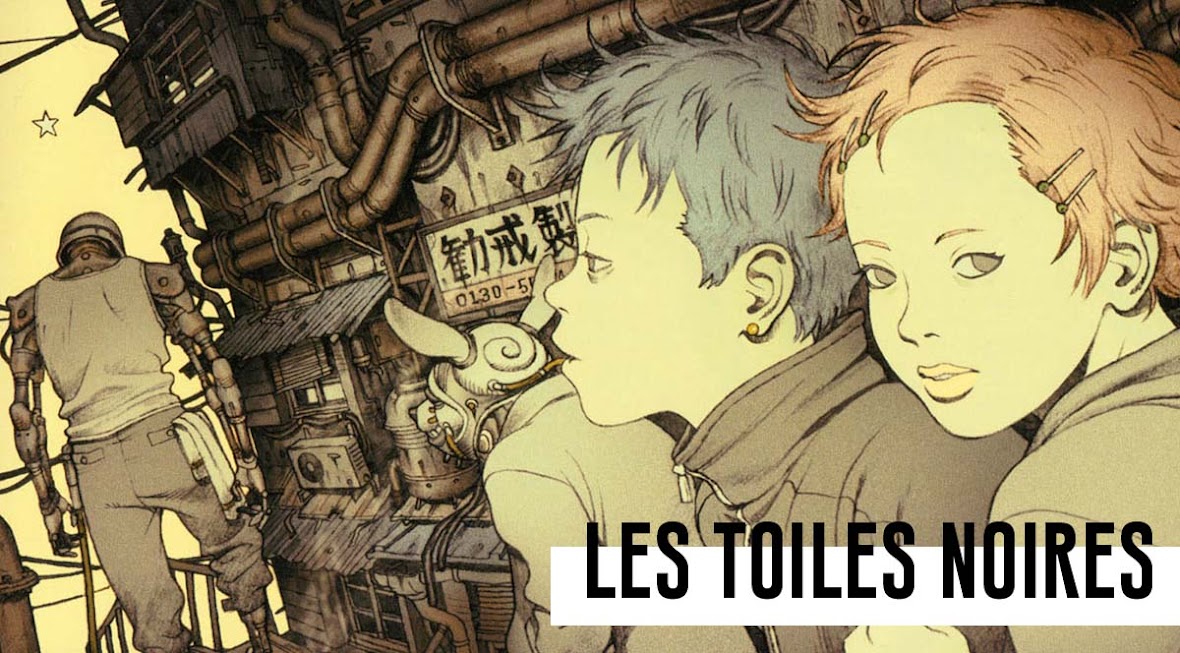Réalisé par Edgar Wright
Cet article contient des spoilers.
Après avoir dépoussiéré les films de morts vivants avec une irrévérence délicieuse, Edgar Wright retrouve ses compères Simon Pegg et Nick Frost pour une seconde aventure tout aussi audacieuse. Hot Fuzz est le second opus de ce que l'on nomme communément la ice & cream trilogy, un trio de longs métrages s'aventurant dans l'exercice dangereux de l'hommage envers des genres cinématographiques ciblés. Après le film de zombies, le réalisateur s'attaque au film d'action hollywoodien (la glace, récurrente dans chacun de ces films, sera ici bleue, en référence à la couleur qu'arborent les forces de l'ordre), mais pas de la manière la plus évidente : en effet, Edgar Wright va rapidement prendre le spectateur à contre-pied à travers une introduction aussi fonctionnelle qu'hilarante. Nicholas Angel (joué par Simon Pegg) est le meilleur policier londonien, tout lui réussit, si l'on excepte sa vie sentimentale, qu'il délaisse justement au profit de son travail. Rapidement, le personnage se retrouve exilé de la capitale anglaise, pour finalement atterrir dans le petit village de Sandford situé dans le Gloucestershire, un comté relativement rural. Le metteur en scène va alors placer son personnage infaillible dans cette petite commune isolée au sein de laquelle la vie suit son cours, le seul mystère vraiment notable s'incarnant dans la disparition d'une oie. Mais le jeu sur les apparences est l'un des exercices préféré d'Edgar Wright, qui va s'amuser à livrer un film haletant, articulé autour d'un complot qui peu à peu prend forme à mesure que surviennent d'étranges accidents.
Après avoir dépoussiéré les films de morts vivants avec une irrévérence délicieuse, Edgar Wright retrouve ses compères Simon Pegg et Nick Frost pour une seconde aventure tout aussi audacieuse. Hot Fuzz est le second opus de ce que l'on nomme communément la ice & cream trilogy, un trio de longs métrages s'aventurant dans l'exercice dangereux de l'hommage envers des genres cinématographiques ciblés. Après le film de zombies, le réalisateur s'attaque au film d'action hollywoodien (la glace, récurrente dans chacun de ces films, sera ici bleue, en référence à la couleur qu'arborent les forces de l'ordre), mais pas de la manière la plus évidente : en effet, Edgar Wright va rapidement prendre le spectateur à contre-pied à travers une introduction aussi fonctionnelle qu'hilarante. Nicholas Angel (joué par Simon Pegg) est le meilleur policier londonien, tout lui réussit, si l'on excepte sa vie sentimentale, qu'il délaisse justement au profit de son travail. Rapidement, le personnage se retrouve exilé de la capitale anglaise, pour finalement atterrir dans le petit village de Sandford situé dans le Gloucestershire, un comté relativement rural. Le metteur en scène va alors placer son personnage infaillible dans cette petite commune isolée au sein de laquelle la vie suit son cours, le seul mystère vraiment notable s'incarnant dans la disparition d'une oie. Mais le jeu sur les apparences est l'un des exercices préféré d'Edgar Wright, qui va s'amuser à livrer un film haletant, articulé autour d'un complot qui peu à peu prend forme à mesure que surviennent d'étranges accidents.
Après des années passées à engloutir des Point Break (Kathryn Bigelow, 1991), Bad Boys (Michael Bay, 1995) et autres Die Hard (John McTiernan, 1988), la joyeuse équipe anglaise maîtrise désormais les codes, les clichés et la construction narrative de tous ces films d'action qui ont bercé leur adolescence. Edgar Wright a aussi potassé le livre The Little Book of Hollywood Cliches de Robert Ebert, qui propose un état des lieux de tous les gimmicks qui se retrouvent d'un film à l'autre. Et à l'image du travail effectué sur Shaun of the Dead, jamais ils ne vont enfourcher la monture du cynisme propre au vingt-et-unième siècle, lui préférant une approche teintée d'un amour démesuré pour le genre et le cinéma en général. La prémisse du long-métrage est d'une banalité confondante, le spectateur étant invité à suivre un couple de policiers que tout oppose, qui vont finalement se comprendre et entrer en symbiose à mesure qu'ils franchissent des épreuves prévues pour façonner leur psyché et accentuer leur évolution. Bien évidemment, Edgar étant ce qu'il est, le réalisateur va prendre un malin plaisir à détourner ce cliché, en y apposant une couche d'humour anglais exquis et des références ludiques en cascade. Nicholas Angel et son comparse Danny Butterman (l'excellent Nick Frost), seuls contre le reste du monde, littéralement, étant donné la nature même de la menace qui pèse sur Sandford. Un duo autour duquel gravitent une pléthore de rôles secondaires nécessaires et cohérents, jusque dans la révélation finale qui s'érige comme un hommage appuyé et efficace au roman Le Crime de l'Orient Express, d'Agatha Christie (1934). Wright tisse un réseau de personnages qui se distinguent tous par une mimique, un caractère, une particularité (le gérant de la supérette qui joue sur les sous-entendus, la policière portée sur les jeux de mots coquins, le colosse nigaud qui ne s'exprime que par des onomatopées, et ainsi de suite), sur lesquels le spectateur porte ses soupçons, se prenant au jeu proposé par le film.
En plongeant à pieds joints dans la citation assumée, le metteur en scène en profite pour installer une zone de confort qu'il se plaira à faire voler en éclats à l'aide de plusieurs artifices maîtrisés. Ainsi, le film propose quelques élans violents et gores qui contrastent sévèrement avec le calme apparent de Sandford, comme lorsqu'une victime reçoit un morceau d'église sur le crâne. Une scène choc qu'Edgar Wright désamorce immédiatement à travers un plan large présentant le pauvre homme déambuler, un immense cône inversé à place de la tête, gravant sur la pellicule une image d'un surréalisme halluciné. Un autre sursaut intervient à la fin du film, qui pastiche allègrement les séquences finales des films d'action américains, lorsque le duo principal se retrouve à affronter tous les villageois armés jusqu'aux dents, une référence évidente aux gunfights survoltés qui pullulent dans ce genre de productions. De la même manière, une bagarre se déroule aux côtés de la maquette du village, ce qui singe les scènes de destructions massives qui concluent en apothéose les blockbusters contemporains. Ainsi, Edgar Wright donne à voir au spectateur ce qu'il est venu chercher (des fusillades, des explosions) mais sous une forme détournée intelligente, au service de l'humour, tout en incarnant une réflexion sur le genre. En effet, le réalisateur prouve qu'il est possible d'exploiter les codes d'un genre cinématographique tout en se renouvelant, une option qu'oublieront les studios hollywoodiens les années suivantes, livrant des productions aux climax interchangeables.
Hot Fuzz distille tout au long de ses 121 minutes des références aussi subtiles que touchantes à l'histoire du cinéma, et ce jusque dans les détails les plus minuscules. Ainsi, le bruit des sirènes entendues au début du film constituent une rétrospective des différents sons utilisés tout long de l'histoire. Une myriade d'acteurs connus participent au film, au grand jour (Timothy Dalton, impeccable dans son rôle d'antithèse de James Bond, l'inénarrable Jim Broadbent) ou dissimulés (Peter Jackson grimé en Père Noël, Cate Blanchett jouant le rôle de la petite amie de Nicholas dont on ne voit jamais le visage, voire Wright lui-même), ce qui ravit à la fois l'équipe, enchantée de travailler aux côtés d'acteurs qu'ils adorent, mais aussi le spectateur, surpris de retrouver ces têtes connues dans ce long-métrage décalé. En termes de mise en scène et de montage, le réalisateur cite allègrement le style de Tony Scott, avec cette caméra à la main, ou ces séquences présentant Nicholas s'atteler à la paperasse. La référence à Léon (Luc Besson, 1994) est plus subtile, elle s'incarne dans le fait que le policier parfait voyage sans quitter sa plante verte, un clin d'œil qui parlera aux fans du film français. Parfois, les citations sont plus visibles, comme la reprise d'une scène culte du film Point Break, lorsque Danny tire en l'air, de rage. Il arrive même que le réalisateur se cite lui-même à travers un gag qui ponctuera les trois épisodes de sa trilogie thématique, qui voit Simon Pegg enjamber une palissade avant de s'affaler lamentablement sur le sol. Ces références envahissent littéralement Hot Fuzz, sans jamais le phagocyter, car Edgar Wright et son équipe se les approprient, les digèrent et les détournent. Il en résulte paradoxalement un film universel qui parlera au plus grand nombre, certains y retrouvant une zone de confort instaurée par la vision de films du même genre, mais le long-métrage développe aussi une identité propre, surlignée par ce duo si particulier qui habite l'écran.
Ce sens du détail et ses références se retrouvent jusque dans la bande-son du film, très hétéroclite, alimentée par des morceaux aux ambiances et influences variées, mais dont les titres font toujours référence à la situation en cours. Par exemple, certaines musiques voient leurs titres entrer en résonance avec la façon dont meurent les victimes. Le reste des compositions possèdent un rôle "décoratif", à l'image de ce qui a été fait pour Shaun of the Dead. L'accompagnement sonore développe des atmosphères, des ambiances, mais ne gravent jamais de mélodie mémorable dans le crâne du spectateur, à quelques exceptions près. Très peu de morceaux originaux sur cette bande-son, mais il faut signaler la participation de Robert Rodriguez (réalisateur de Sin City, Une Nuit en Enfer ou The Faculty), qui a composé deux pièces sans même avoir les images devant les yeux.
Le dernier point fort du long-métrage, et non des moindres, est sa narration. Comme dans tous les films du réalisateur, elle est originale, cohérente et ludique. Le montage s'adapte aux émotions et sentiments des personnages, les angles de vue sont efficaces, permettant parfois la mise en place de gags purement visuels, tandis que l'écriture elle-même est un hommage à la technique dite du fusil de Tchekhov, nommée ainsi par le dramaturge du même nom qui explique que si, dans une histoire, l'auteur indique qu'un fusil est placé sur le mur, alors il doit absolument être utilisé avant la fin. Hot Fuzz est une illustration absolue de ce concept, tant le premier acte du film met en place des éléments qui resurgiront dans la conclusion. Même les personnages secondaires croisés l'espace de quelques secondes seront mis au service de ce procédé narratif. Chaque élément du film se fait le témoin de la rigueur dont fait preuve le réalisateur en écrivant son film.
Si le spectateur peut découvrir en Hot Fuzz un film policier efficace à la personnalité marquée, le cinéphile y verra une déclaration d'amour envers tout un pan du cinéma d'action et de suspense. Porté par des acteurs impliqués et talentueux, le film d'Edgar Wright dévoile un microcosme épatant de maîtrise, nimbé d'une aura de mystère. En jouant sur les apparences, le long-métrage confirme le talent du metteur en scène, lequel n'hésite jamais à puiser dans un bocal de références cinématographiques, lesquelles confèrent à cette histoire un parfum d'hommage assumé, bien que le film ne ressemble à rien de connu si ce n'est à l'esprit débridé de Wright, bien parti pour devenir l'un des réalisateurs les plus importants de ce début de siècle.
Cliquer ici pour revenir à l'index