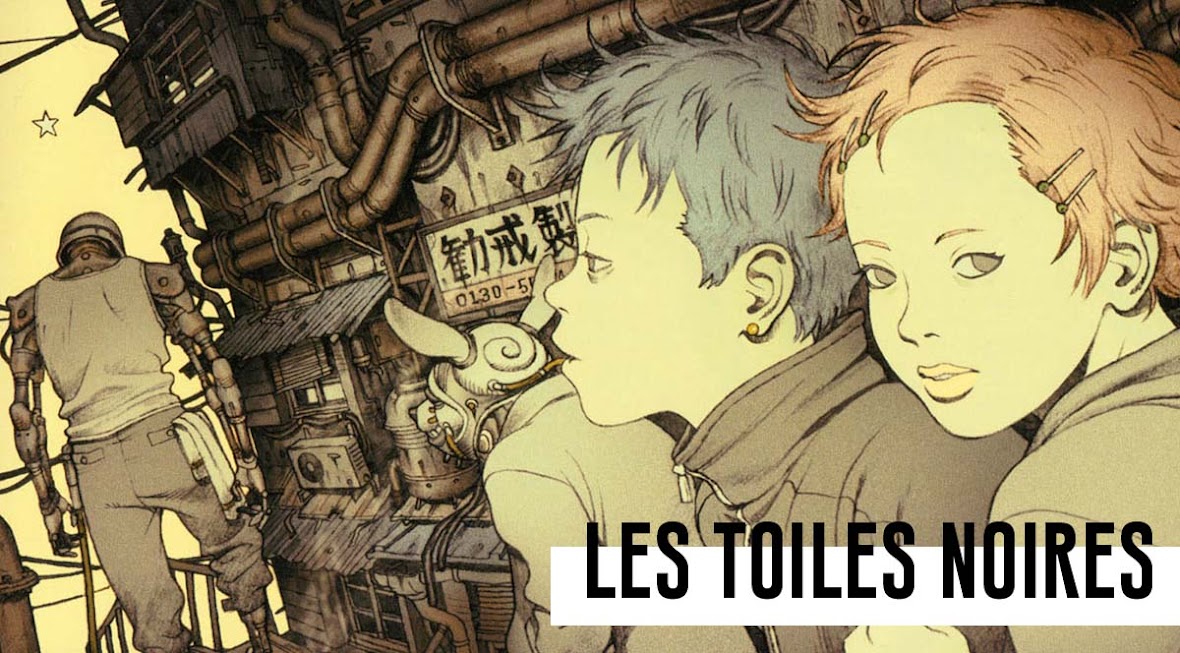Réalisé par Wes Anderson
Cet article contient des spoilers.
Tel un Tim Burton rococo, Wes Anderson a su donner vie à un univers parallèle aux codes prégnants, un univers identifiable entre mille: le sien. Dire du réalisateur qu'il est parvenu à détourner les codes visuels d'un cinéma de plus en plus balisé, tout en se réappropriant ceux de la narration, n'est qu'une esquisse de la réalité tant l'innovation semble gouverner sa carrière. Avec The Grand Budapest Hotel, le metteur en scène fait fi de la retenue et s'emploie à livrer une œuvre totale et sans concession, s'extirpant du carcan commun de la comédie afin de côtoyer des genres auxiliaires tels que le film d'évasion, la comédie romantique ou encore, en toute subtilité, le film historique.

Zero Moustafa, interprété avec autant de panache que de retenue par le fantastique Tony Revoli, est un lobby boy employé dans les couloirs de l'illustre Grand Budapest Hotel, un établissement situé au cœur d'une chaîne montagneuse de Zubrowka, un pays fictif, évident pastiche d'une Europe de l'Est aussi élégante que caricaturale. C'est le parcours de ce charmant personnage que le spectateur est amené à suivre, à travers le temps, le film jonglant entre les époques (1985, 1968 et les années 30). Ces changements temporels sont bien évidemment illustrés à l'image, Wes Anderson étant un réalisateur visuel, qui s'amuse à faire avancer la narration non seulement à travers l'action, mais aussi via l'esthétisme même de ces métrages. Ainsi, le format d'image basculera du traditionnel 1.85 au rétro 1.33, en passant par le cinémascope, ces formats correspondants aux décennies qu'ils illustrent, (ceci constituant la meilleure façon de lier le visuel à la narration). Toute la direction artistique s'adapte elle aussi aux époques visitées, et ce jusque dans les moindres détails, comme l'attestent les matériaux utilisés pour la construction des décors, différents selon les périodes qu'ils contribuent à illustrer. Bien que le bâtiment servant de terrain de jeu au réalisateur et acteurs existe réellement (il s'agit d'un ancien grand magasin construit en 1912 !), une maquette a été construite dans le but d'illustrer les plans larges, optant pour un rendu tantôt réaliste, parfois artificiel. Wes Anderson se tient d'ailleurs à une ligne directrice évidente: à mesure que le film bascule d'un supposé présent à un passé oublié, l'esthétique et la mise en scène sombrent lentement vers une mise en avant de ce côté artificiel. Comme si en plongeant dans le passé, le réalisateur s'éloignait du réel, à travers la mise en scène de souvenirs fantasmés, qui pourraient se permettre d'altérer quelque peu la réalité sans que cela ne puisse nuire à l'implication du spectateur. D'une réalité relativement terne, au fur et à mesure que le film remonte le temps, apparaissent de nouvelles couleurs, des cadrages plus travaillés et bien entendu ce style identifiable entre mille si cher à Wes Anderson. Cet aspect artificiel est également retranscrit par le cadre géographique du film, prenant place en Zubrowka, un état chimérique qui s'érige sans mal en reflet d'une Europe de l'Est imprenable. Un élément rapidement contrasté par le nom même du fameux hôtel, qui lui fait bel et bien référence à la capitale hongroise.
Bien sûr, il y a dans
The Grand Budapest Hotel quelques touches héritées d'autres réalisateurs, Anderson avouant volontiers être grandement influencé par l'œuvre d'Ernst Lubitsch, un réalisateur américain d'origine allemande, qui travaillait également énormément l'aspect esthétique de ses films, tout en accordant une place prépondérante à l'accompagnement musical et aux péripéties. Les comédies qui ont marqué le début de sa carrière partagent quelques points communs avec les films de Wes Anderson, et particulièrement
The Grand Budapest Hotel. Il suffit de découvrir
La Poupée (
Die Puppe, 1919) pour retrouver des plans et une écriture sensiblement proches. Il y a un aspect caricatural des personnages et d'autres similarités telles que la composition de quelques plans qui résonnent clairement comme un hommage envers le cinéaste aujourd'hui disparu. Loin de s'en cacher, Anderson clame haut et fort cette inspiration, sans négliger d'apporter sa patte toute particulière à son film, notamment en termes d'écriture, comme l'illustre cette propension à accabler le spectateur d'informations continues, plus ou moins utiles, qui tendent à directement capter son attention tout en le noyant sous une masse de données. Sans oublier ce jeu sur la narration: tandis que l'on découvre un romancier vieillissant, de successifs sauts dans le temps nous mènent directement au sujet de son livre. Comme pour rappeler que les histoires ramènent le passé à la vie. Comme pour dire que ce qui peut occuper quelques heures ou minutes de notre existence, qu'il s'agisse de la lecture d'un livre ou la vision d'un film, sont des événements qui ont rythmé la vie entière d'autres personnes. Mais Wes Anderson est un petit malin, et le personnage principal de son histoire ne sera pas celui mis en avant par le film, à savoir Zero, il s'agira davantage du magistral Monsieur Gustave, interprété par un Ralph Fiennes illuminé, et qui donne son nom au premier chapitre du film.
En effet, le "Chapitre I: Monsieur Gustave" illustre cette habitude maladive qu'a Wes Anderson de tout classifier, d'étiqueter, de trier. Son monde, et ses films, sont organisés selon des structures fixes se répercutant à la fois dans la composition visuelle et dans la narration, une technique qui permet au metteur en scène de mieux dynamiter ses propres créations à l'aide d'éléments perturbateurs participant à la progression de l'histoire. C'est en brisant ses propres règles que Wes Anderson ajoute des effets comiques ou dramatiques, tout en se permettant quelques fulgurances à même de désarçonner le spectateur. Des contrastes se créent entre la mise en scène sophistiquée et ces "explosions", comme lorsque les grands discours sont interrompus par des interventions extérieures, voire par les personnages eux-mêmes (songeons à Monsieur Gustave qui se lance à lui-même un audacieux "fuck it" avant de stopper le monologue barbant qu'il ressassait). Un autre exemple de ces coupures intervient lorsque des policiers viennent interroger ce même Monsieur Gustave à propos du meurtre de la Comtesse, et que celui-ci surprend son monde en s'enfuyant de la plus risible des façons, malgré son innocence. Cette scène illustre d'ailleurs l'un des nombreux talents de mise en scène de Wes Anderson, capable de gérer le rythme de ses travaux avec une précision chirurgicale, passant de l'immobilisme à l'emballement de la manière la plus juste, toujours dans l'optique de servir le récit. Cette maîtrise rythmique permet au metteur en scène de toujours souligner les éléments les plus importants, en utilisant le temps mis à sa disposition pour mettre en avant un élément spécifique n'ayant aucun rapport avec la séquence en cours (juste pour préciser ou rappeler son existence), de manière à aiguiller au mieux le spectateur perdu parmi la tonne d'informations qui lui tombent dessus. Enfin, pour en revenir à l'utilité de ce monde structuré qui vole en éclats lorsqu'Anderson s'amuse à le perturber, comment ne pas souligner la réussite visuelle de plusieurs gags construits autour de cette idée, comme lorsqu'un plan présente le petit Zero aux pieds d'un immense portail infranchissable, se demandant comment il va bien pouvoir vaincre cet obstacle, lorsque soudain s'ouvre une toute petite porte en bas de la barrière. Ou comment, en seulement une image et un repositionnement du regard, Wes Anderson manipule les changements de tons avec une aisance folle.

Cette orientation originale, articulée autour d'une pléthore de décalages, ne favorise cependant pas l'implication émotionnelle, tant les péripéties sont rythmées par d'étranges fulgurances narratives ou visuelles. Cependant, difficile de ne pas s'enthousiasmer face à cet enchaînement de séquences improbables, le métrage distillant sournoisement un plaisir brut et immédiat. Ce manque d'attachement envers les personnages peut aussi résonner à travers la présence d'une entité qui les domine tous: le Grand Budapest Hotel lui-même. D'abord décrépi, comme le découvre le spectateur dans la première période de la narration, l'hôtel s'illumine ensuite, s'étirant de toute sa gloire par-delà même les personnages qui s'y débattent, comme autant d'organes qui le maintiendraient en vie. Le film entier n'est qu'une tentative de faire vivre à nouveau cet édifice, peu importe qu'il paraisse si artificiel, tel un souvenir qui s'effrite lentement, vision fantasmée et glorifiée d'un passé décomposé. Les différents artifices qu'exploite Wes Anderson, et qui confèrent au film cette aura joviale qui ne s'exprime qu'à travers des décors aux allures de pâtisseries, voire tout au long de séquences comiques, ne servent qu'à dissimuler les élans de pure tragédie qui émaillent l'histoire, hantée par la mort. Le contexte historique lui-même, quoi que relativement édulcoré voire totalement éludé, ne parvient au spectateur qu'à travers des bribes de dialogues ou des détails quasi invisibles. Le film évoque souvent la mort de protagonistes secondaires, voire de personnages absents de l'histoire, tout en tissant quelques sombres pistes porteuses d'un sens aussi lourd qu'évocateur, comme lorsque sont cités des "clients aux cheveux tout blonds". Sans oublier le costume des prisonniers, dont l'allusion évidente aux camps de concentration ne peut être niée. Il est intéressant de noter le lien qu'entretient cette attitude élusive avec le comportement même de plusieurs personnages, Monsieur Gustave en tête, qui s'évertue à se soumettre aux codes de la bienséance, dans un monde qui se déshumanise allègrement tout autour de lui. Mais plus encore que ces personnages, c'est donc le Grand Budapest Hotel lui-même qui représente l'injuste sentiment d'impuissance qui devait terrasser les populations en ces temps troublés. La mort, donc, domine le récit, frappant les personnages principaux avec une exhaustivité effroyable. Qu'il s'agisse de Monsieur Gustave ou d'Agatha, interprétée par une Saoirse Ronan touchée par la grâce, la disparition couvre le récit avec une rigueur glaciale. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'élément déclencheur de l'intrigue n'est rien d'autre qu'un meurtre. Ainsi,
The Grand Budapest Hotel s'érige soudainement comme la tentative d'illustrer la résurrection de tout ce petit monde qui s'ébat joyeusement tout au long du métrage. Comme le font les livres ou les films, témoins artificiels de passés révolus.
La musique participe aussi à cette volonté d'intemporalité. Confiée aux bons soins de l'incroyable Alexandre Desplat, compositeur protéiforme capable d'adapter son style en fonction du réalisateur, l'artiste a déjà travaillé aux côtés des plus grands, tels que Terrence Malick (The Tree of Life), David Fincher (L'Étrange Histoire de Benjamin Button) ou encore Roman Polanski (La Vénus à la Fourrure). Décrite par son auteur comme "the sound of Mittel-Europa", la bande-son du film de Wes Anderson prend les allures d'une toile dont les couleurs évoquent une mythologie sonore typique de l'Europe de l'Est, tout en jouant sur l'aspect caricatural de ces musiques. Tel le film qui n'hésite jamais à noyer le spectateur sous une multitude d'informations, d'événements ou de péripéties, la bande-son de Desplat déborde d'instruments: cithares, chants grégoriens, balalaïkas russes, clochettes et autres chœurs se débattent et confèrent à la musique son exotisme solennel. Le rythme métronomique qui régule ces compositions n'est pas sans rappeler les travaux précédents de Desplat pour Anderson, pour lequel il a déjà signé les bande-sons de Fantastic Mr. Fox et Moonrise Kingdom. Chaque piste développe une ambiance propre qui s'engouffre parfaitement dans la tonalité globale de l'œuvre, grâce à une stylisation sonore qui confère aux morceaux un rendu absolument unique. Il est marrant de retrouver les tics de réalisation de Wes Anderson dans la musique de Desplat, tant dans les changements de rythmes soudains, les ambiances qui passent du lumineux aux ténèbres en un instant, voire dans la précision quasi chirurgicale des séquences qui se déploient avec un rythme précieux. Les deux hommes étaient tout simplement faits pour se rencontrer.

Lorsque surgit la fin du métrage, le réalisateur mentionne le nom de Stefan Zweig, auteur viennois dont les œuvres retentissent toujours avec autant de justesse de nos jours, et qui partage avec Anderson un rapport particulier envers l'imaginaire. Tous deux ont décidé de plonger dans des mondes qui n'existent pas, au détriment du réel, tous deux érigent le faux, l'artificiel, comme des valeurs plus importantes que la réalité, qui parviennent à la supplanter. C'est en analysant cette manière d'appréhender les choses, que toute la puissance de The Grand Budapest Hotel peut éclore. En maîtrisant la narration, le rythme, les cadrages, la composition ou encore la multitude de détails qui donnent vie à son univers, Wes Anderson transcende le statut artificiel de son film, pour le rendre au contraire universel.
Cliquer ici pour revenir à l'index